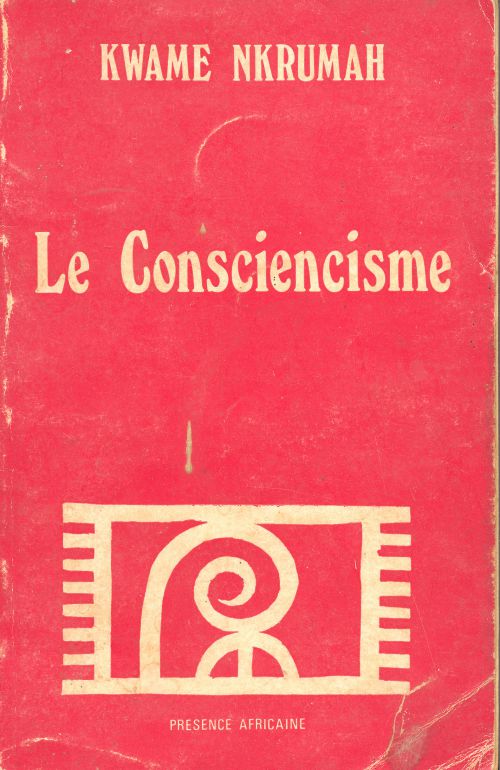Kwame Nkrumah. Le Consciencisme (Extrait)
[Extrait de Nkwame Nkrumah. Le Conciencisme. éditions Présence Africaine, 1976, Paris. Ch IV, pp. 97 -129]
[p.9]
INTRODUCTION
Tout naturellement, la division de l’Afrique affecta l’instruction des Africains colonisés. Il allait de soi que les étudiants des pays anglophones se rendent en Angleterre, tout comme il allait de soi que ceux des pays francophones se rendent en France. De la sorte, le besoin de formation théorique, que les étudiants africains ne pouvaient satisfaire qu’au prix d’un grand effort, de beaucoup de volonté, et de grands sacrifices, se heurtait aux barrières dressées par le système colonial.
Refusant cette limitation imposée à leur liberté, un certain nombre d’entre nous tentèrent d’étudier ailleurs que dans le pays de la puissance qui nous administrait. C’est ainsi que j’en vins à trouver dans l’Amérique un pays occidental où l’on constatait avec plaisir l’absence du colonialisme propre à l’Afrique. C’est donc en Amérique que j’allai ; dans mon autobiographie intitulée Ghana, j’ai déjà raconté comment et en quelles circonstances, je passai presque dix années aux Etats-Unis, étudiant et gagnant ma vie, enseignant et poursuivant mes recherches personnelles.
Apprécier sa propre situation sociale fait partie de l’analyse des faits et des événements, et je crois que cette sorte d’appréciation est, pour la recherche des rapports entre philosophie et société, un point de départ qui en vaut bien un autre. En ce qui concerne la compréhension de la société humaine, la philosophie exige une analyse des faits et des événements, et un effort pour voir comment ils s’articulent [p.10] avec la vie humaine, constituant ainsi l’expérience de l’humanité. Par-là, la philosophie, comme l’histoire, peut contribuer à enrichir, et même à définir, cette expérience.
Les dix années que je passai aux Etats-Unis furent une période décisive du développement de ma conscience philosophique. Celle-ci s’éveilla pour la première fois aux universités Lincoln et de Pennsylvanie. Je fus initié aux grands systèmes philosophiques du passé, auxquels les universités occidentales ont donné leur bénédiction, les disposant et les classant avec le soin délicat dont on entoure les pièces de musée. Dans ces conditions, il était naturel que ces systèmes fussent considérés comme des monuments de la pensée humaine. Or les monuments, représentant la perfection de leur époque précise, ne tardent pas à dater, par l’impression qu’ils font sur la postérité.
Je fus initié à Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx et autres immortels, que l’on me permettra d’appeler des philosophes universitaires. Mais ces géants étaient présentés d’une façon telle qu’un étudiant venu des colonies ne pouvait guère manquer d’éprouver des sentiments contradictoires. Ces sentiments peuvent, si un tel étudiant se consacre finalement à la politique, avoir des conséquences pour toute une société.
Par ses origines, un étudiant des colonies n’appartient pas à l’histoire intellectuelle dont ces philosophes universitaires sont les impressionnants jalons. L’étudiant des colonies peut être séduit par ces tentatives d’explication du monde au point de leur abandonner toute sa personnalité. S’il le fait, il perd de vue le fait social fondamental qu’il est un homme colonisé. Par-là, il se prive de retirer de son instruction et de la peine que se sont donnée les grands philosophes pour examiner les problèmes humains une connaissance qu’il pourrait appliquer au problème très concret de la domination coloniale, laquelle, en fait, détermine la vie quotidienne de tout Africain vivant sous un tel régime.
[p.11] Plein de naïve admiration, l’étudiant des colonies cherche son chemin à travers les méandres des systèmes philosophiques. Pourtant, ces systèmes n’ont pas été conçus pour proposer une situation du monde tel qu’il se présente à son époque à lui. Car les systèmes philosophiques eux-mêmes sont des faits datés ; au moment où les universités leur font une place dans leur enseignement, ils ont perdu leur dynamisme premier, leur énergie polémique. Cela vient du traitement que les universités leur font subir, du fait de leur attitude à cet égard : tout se passe comme si ces systèmes n’étaient pour elles que des propositions entre lesquelles il y aurait des rapports logiques.
Plusieurs catégories d’étudiants des pays coloniaux furent victimes de cette mauvaise façon d’aborder la culture. Beaucoup d’entre eux avaient été triés sur le volet et, si l’on peut dire, portaient sur eux un certificat de garantie.
On estimait qu’ils feraient de bons serviteurs de l’administration coloniale. La formation de cette catégorie d’étudiants commençait généralement très tôt, et il n’était pas rare qu’ils eussent, tout jeunes, perdu contact avec leur milieu naturel. Ainsi déracinés, ils étaient prêts à accepter n’importe quelle théorie de l’universalisme, à condition qu’elle fût exprimée en termes vagues, du type pâte de guimauve.
Armés de leur universalisme, ils ramenaient de l’université une attitude entièrement étrangère à la réalité concrète de leur peuple et de sa lutte. Quand ils rencontraient des doctrines de type militant, comme celles du marxisme, ils les réduisaient à d’arides abstractions, à des subtilités oratoires. Ainsi, grâce aux faveurs de leurs patrons colonialistes, ces étudiants, désormais habiles à se faire, des problèmes sociaux et politiques, une idée non pas fondée sur la réalité du milieu, mais abstraite et « libérale », commençaient à remplir les espérances de leurs seigneurs et maîtres.
Un petit nombre d’étudiants des colonies accédaient aux [p.12] universités de la Métropole presque de droit, en vertu de leur situation sociale. Au lieu de considérer la culture comme un privilège et un agrément, les intellectuels sortis de ce milieu voyaient en elle un moyen de se distinguer. Les colonialistes les avaient peut-être un peu brimés, mais ils n’en avaient jamais vraiment souffert. Du haut de leur branlant piédestal, ils s’intéressaient à l’histoire et à la sociologie de leur pays, en s’arrangeant pour jouer un certain rôle positif dans l’évolution nationale. Il n’en reste pas moins évident que le degré de conscience nationale auquel ils parvenaient ne leur permettait pas de voir dans toute leur ampleur les lois du développement historique, ni le caractère radical de la lutte qu’il fallait mener si l’on voulait conquérir l’indépendance nationale.
Il y avait, enfin, la grande masse des Africains ordinaires qui, animés par une vive conscience nationale, cherchaient dans la connaissance un instrument d’émancipation et d’intégrité nationales. Cela ne veut pas dire que ces Africains n’étaient pas sensibles à l’aspect purement culturel de leurs études. Mais, pour que la culture qu’ils acquéraient fût de quelque valeur, ils voulaient pouvoir l’apprécier en hommes libres.
J’étais de ce nombre.
[…]
[p.97]
Chapitre IV
LE CONSCIENCISME
La pratique sans théorie est aveugle ; la théorie sans pratique est vide. Les trois fractions de la société africaine que j’ai distinguées au chapitre précédent (traditionaliste, occidentale et musulmane) coexistent difficilement : les principes dont elles se réclament sont souvent en contradiction. A titre d’exemple, j’ai tenté de montrer que les principes du capitalisme occidental sont en conflit avec l’égalitarisme socialiste de la société africaine traditionnelle.
Que faut-il donc faire ? J’ai insisté sur le fait que les deux autres fractions doivent, si l’on veut se faire une opinion correcte, n’être considérées que comme des expériences de la société africaine traditionnelle. Si nous oublions cela, notre société sera rongée par la plus maligne des schizophrénies.
Notre attitude envers l’expérience occidentale et musulmane doit être raisonnée, guidée par une pensée, car la pratique sans théorie est aveugle. Ce qu’il nous faut d’abord, c’est un corps de doctrines qui déterminera la nature générale de notre action consistant à unifier la société dont nous avons hérité, cette unification devant constamment tenir compte de l’idéal élevé qui est à la base de la société africaine traditionnelle. La révolution sociale doit donc s’appuyer fermement sur une révolution [p.98] intellectuelle, dans laquelle notre pensée et notre philosophie seront axées sur la rédemption de notre société. Notre philosophie doit trouver ses armes dans le milieu et les conditions de vie du peuple africain. C’est à partir de ces conditions que doit être créé le contenu intellectuel de notre philosophie. L’émancipation du continent africain, c’est l’émancipation de l’homme. Cela requiert deux buts : premièrement, reconstituer la société égalitaire ; secondement, mobiliser logiquement toutes nos ressources en vue de cette reconstitution.
La philosophie qui doit soutenir cette révolution sociale est celle que je me suis proposé d’appeler « consciencisme philosophique » ; le consciencisme est l’ensemble, en termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine. Celle-ci se définit elle-même par l’ensemble des principes humanistes sur quoi repose la société africaine traditionnelle. La philosophie appelée « consciencisme » est celle qui, partant de l’état actuel de la conscience africaine, indique par quelle voie le progrès sera tiré du conflit qui agite actuellement cette conscience. Son fondement est le matérialisme. L’affirmation minimale de celui-ci est l’existence absolue et indépendante de la matière. Mais la matière est aussi un faisceau de forces opposées. L’intérêt philosophique de cette affirmation est qu’ainsi, la matière a le pouvoir de se mouvoir d’elle-même.
Il y a, bien entendu, plusieurs sortes de mouvements. Les philosophes ont admis que divers phénomènes peuvent porter ce nom. Il y a le cas évident du déplacement. Si un objet change de position par rapport aux autres objets d’un espace, on dit qu’il bouge. Par opposition à cette hypothèse on pourrait également affirmer que c’est l’univers entier qui tourne sans symétrie autour de l’objet ; auquel cas, en termes d’absolu, on pourrait dire que l’objet n’a pas bougé.
[p.99] Si cette seconde hypothèse était réelle, elle ne se distinguerait pas du premier cas, dans lequel l’objet change de position relative au reste de l’univers. Entre les deux cas, il n’y a pas de différence apparente et s’ils sont équivalents, le second ne peut constituer une objection au premier.
Dire qu’un objet bouge a un sens. Et quand on ne constate pas de différence entre deux affirmations ayant un sens, elles ne peuvent qu’avoir le même sens. Ce que je dis là est tout à fait différent du principe de vérification, qui, on le sait, comprend deux parties : pour commencer, on établit qu’une proposition n’a de sens que si elle est sujette à une vérification empirique ; ensuite, on affirme qu’une proposition ayant un sens est donnée par la méthode de vérification. Le principe que je soutiens, en revanche, ne pose aucune condition pour que quelque chose ait un sens, mais établit une condition suffisante pour qu’il y ait identité de signification. Voici quelle en est l’idée centrale : s’il y a deux expressions telles que les mêmes conséquences exactement découlent de la conjonction de la première et de n’importe quelle autre proposition découlant de la conjonction de la seconde et de cette même proposition, les deux expressions ont le même sens.
On aura compris que ce principe d’identité de signification est apparenté à ceux que proposent Leibniz et Frege. J’ai décrit une variété de mouvement acceptée par les philosophes. Ils distinguent aussi le mouvement rotatoire, dont Platon donne pour exemple celui d’une toupie. Mais il y a une troisième sorte de mouvement : la modification de la propriété. S’il faut distinguer les propriétés des relations, on dira qu’il y a deux grandes catégories de mouvements : ceux qui provoquent des changements de relation et ceux qui provoquent des changements de propriété ; on voit que le mouvement linéaire et le mouvement rotatoire entraînent un changement de relation. S’il existe ces deux sortes de mouvements, l’un aboutissant à un changement de relation, l’autre à un changement de propriété, [p.100] quand on dit que la matière a originellement le pouvoir de se mouvoir d’elle-même, cela n’implique nécessairement ni l’un des mouvements, ni les deux ensemble.
Il est de bon ton, en particulier chez les philosophes que la dialectique n’intéresse pas, de dire que la matière est inerte. Le sens de cette affirmation doit être distingué de ce que représente l’inertie de la matière pour Newton. Newton définit l’inertie axiomatiquement, dans sa première loi sur le mouvement, par exemple. Selon cette loi, un corps qui ne subit pas de forces extérieures continue son déplacement uniforme en ligne droite. Le repos est aisément expliqué comme cas limite de mouvement en ligne droite. Or, au lieu de donner une définition directe d’un terme introduit, il est tout à fait approprié d’en indiquer le sens par des axiomes. En fait, les axiomes établiront ce que l’on aurait déduit de l’usage du terme introduit. Dans le cas de la première Loi de Newton, on voit que, là aussi, le pouvoir de se mouvoir de soi-même sur une ligne est refusé aux corps. En fait, Newton refuserait aussi à un corps le pouvoir de mouvement rotatoire. Pour reprendre un mot de Whitehead, l’inertie de la matière c’est son entéléchie (pushiness).
Quand on se demande ce que les philosophes entendent par inertie de la matière, on entrevoit quelque chose de différent. En réalité, ils cherchent un parallèle intellectuel au mouvement physique et nient celui de la matière. C’est pourquoi nous les voyons s’en prendre continuellement à la « stupidité » de la matière. Par-là, ils entendent que la matière est incapable d’action intellectuelle : de pensée, de perception et de sentiment. Bien entendu, ils sont reconnaissants à Newton d’avoir dit que la matière est sans activité physique. Ils reprennent cela à leur compte et y ajoutent qu’elle n’a pas non plus d’activité intellectuelle. C’est pourquoi, quand un philosophe dit que la matière est « stupide », il ne veut pas dire qu’elle a l’esprit lent, mais qu’elle n’a pas d’esprit du tout. Mais il n’est pas [p.101] rare qu’en refusant ainsi toute activité, physique ou mentale, à la matière, les philosophes se contredisent eux-mêmes. Si l’on jette un coup d’œil sur le chef-d’œuvre de Locke, l’Essai sur l’entendement humain, on rencontre à chaque instant des contradictions de ce genre. Dans cet ouvrage, Locke nie que la matière soit active ; il attribue toute activité-à l’esprit. Cela ne l’empêche pas de dire, dans sa théorie de la perception, que des corpuscules vont de l’objet perçu à l’organe des sens, afin que nous puissions le percevoir. Il dit que ces corpuscules sont des parties de l’objet perçu, qui s’en détachent et nous soumettent à une sorte de bombardement de radiations. Ici, Locke se contre-dit de façon flagrante. En effet, il ne dit pas que cette activité de la matière est induite, mais qu’elle est originelle, naturelle.
Mais même la théorie de la gravitation universelle, qui explique le mouvement habituel des corps (repos compris), est absolument muette sur la question des antécédents. Elle évite la question de savoir pourquoi les corps bougent, pourquoi, par exemple, les corps célestes sont entrés en mouvement ; elle se demande seulement comment ils restent en mouvement, et pourquoi ils le font de cette manière.
Et pourtant, tous ceux qui conçoivent l’univers comme un « super-atome», dans lequel les tensions se seraient multipliées au point qu’il aurait éclaté, sous-entendent par là même que la matière a le pouvoir de se mouvoir d’elle-même, car ils ne croient pas que cette accumulation originelle de forces internes soit venue d’une influence extérieure.
Le phénomène appelé radiation et la mécanique ondulatoire de la théorie des quanta supposent indubitablement que la matière a originellement le pouvoir de se mouvoir seule, même au sens qui exige autre chose qu’un changement de propriétés. Si la matière est sujette à une émission spontanée, il y a mouvement puisqu’il y a émission de particules, et il y a mouvement indépendant puisque cette émission est spontanée.
[p.102] Les philosophes classiques ont, en fait, attaché trop d’importance à deux considérations au moins. La première est que, grâce à nos fameux cinq sens, nous ne discernons ni la radiation ni le mouvement corpusculaire eux-mêmes.
Cependant, nous voyons monter une pomme lancée en l’air et voler une plume sur laquelle on a soufflé. En revanche, bien que nous sachions qu’il y a des cas où des animaux et des êtres humains sont poussés, nous assistons quotidiennement au phénomène plus manifeste et directement évident du mouvement spontané des êtres vivants. Nos philosophes classiques ont donc, sans plus se poser de question, fermé le dossier ; avec une humeur involontaire, ils confondaient les limites de leur propre entendement et celles de ce qui peut être.
Or, si l’on veut conserver l’idée de l’inertie de la matière, il faut attribuer le mouvement indépendant dont elle est visiblement le siège à quelque principe autre que matériel ; on parle généralement d’âme ou d’esprit. Bien entendu, on peut dire que cette âme ou cet esprit sont soit inhérents, soit extérieurs à la matière. Mais même quand on aura dit qu’il y a dans la matière une âme ou un esprit qui explique son mouvement spontané, on n’aura pas dit que, dans tous les cas de mouvement spontané constatable d’un corps, il faut supposer un esprit, caché dans ce corps, un petit démon habitant la machine. Le principe philosophique de l’inertie de la matière n’est donc pas prouvé simplement en postulant l’esprit ou l’âme. Au fond on fait de l’inertie essentielle de la matière la caractéristique qui la définit.
Si l’on postule une âme ou un esprit, le vitalisme et les diverses formes d’occultisme sont faciles a défendre. Mais là encore, nous trouvons la seconde considération par quoi les philosophes se sont laissé impressionner outre mesure.
C’est l’idée d’intention. On a cru que le mouvement spontané ne pouvait être que délibéré, car, dans tous les cas, on faisait intervenir l’idée d’intention. En même temps, on réservait la possibilité d’avoir une intention aux choses [p.103] vivantes (et encore pas à toutes). Non vivante par définition, la matière fut donc jugée incapable d’intention. Par conséquent, on ne put lui attribuer quelque spontanéité que ce fût. Voilà, en réalité, le fond de ce principe d'inertie étrangement appelé « stupidité ».
En un certain sens, les héritiers des philosophes de l’Antiquité sont, non pas les philosophes d’aujourd’hui, mais ceux qui se livrent aux sciences expérimentales. Après avoir sondé le phénomène des radiations, celui de l’émission spontanée de particules matérielles et le silence de Newton sur la source du mouvement originel des corps, on peut soit, si l’on est un « philosophe de l’inertie », tomber dans un animisme radical et remplir la matière non vivante d’une armée d’esprits, soit, avec raison, renoncer à nier que la matière soit capable de mouvement spontané ; cette négation n’ayant plus de sens désormais.
On peut même dire que le prédécesseur de tous les philosophes occidentaux, Thalès, se trouva placé devant cette alternative. Il avait dit que le monde ne devait pas être expliqué par la « sur-nature », donc que tout est de l’eau. Il eut alors l’idée d’expliquer pourquoi des milliers de choses n’étaient pas « aqueuses ». Le moins qu’il pouvait faire était d’attribuer à l’eau elle-même un principe de changement, tel que, quand il entrait en action, un passage fût possible de l’état que nous appelons « eau » à d’autres états appelés objets. Mais, s’il ne voulait pas renoncer à sa première affirmation (tout est de l’eau), il fallait que le principe ne permît que des transformations géométriques à l’intérieur de l’eau, c’est-à-dire qu’il fût limité dans son application à la raréfaction et à la condensation de l’eau. Il fallait donc que ce fût un principe de mouvement. Thalès déclara donc que les choses étaient pleines de dieux. Cela sent désagréablement l’animisme, mais il voulait simplement démontrer qu’il niait l’inertie de la matière en affirmant qu’elle avait le pouvoir de se mouvoir d’elle-même. En disant que les choses étaient pleines de dieux, il n’en-[p.104]tendait pas que chaque objet était le siège de quelque dieu, car, précisément, toute sa révolution philosophique consistait à neutraliser les dieux, à les rendre incapables d’expliquer les objets et processus du monde. C’est sa langue, et non sa pensée, qui est pittoresque. De même que, plus tard, Aristote fit redescendre les formes du ciel platonicien et les rendit à la matière, Thalès faisait redescendre, du ciel (que les prêtres avaient inventé) dans la matière, la source du mouvement, donc la cause des phénomènes.
La matière n’est pas inerte au sens où l’entendent les philosophes. Elle est capable de se mouvoir elle-même à la fois au sens de changement de relation et de changement de propriétés. Mais la matière a une inertie (inertia). La distinction entre l'inertia (l’inactivité) et l’inertie banale est suffisamment connue; la seconde implique la première, mais non la première la seconde.
Les premiers principes de la philosophie que j’ai appelée « consciencisme » ont donc deux aspects : tout d’abord, j’affirme l’existence indépendante et absolue de la matière ; ensuite, j’affirme qu’elle peut se mouvoir spontanément. En vertu de ces deux premiers principes, le consciencisme est une philosophie profondément matérialiste.
Il est essentiel de faire ici le départ entre le matérialisme impliqué par le consciencisme et le matérialisme qui affirme que seule la matière existe. Au premier chapitre, j’ai montré qu’une philosophie matérialiste qui admet la réalité fondamentale de la matière doit ou bien nier les autres catégories d’êtres, ou bien affirmer que toutes se réduisent, sans reste, à la matière. S’il ne s’agit pas d’un dilemme, le choix est en tout cas souvent pénible. Dans un matérialisme admettant la réalité fondamentale de la matière, si l’esprit est admis comme catégorie d’être, il faut affirmer qu’il est réductible à la matière sans reste. En outre, le phénomène de la conscience, comme celui de la conscience de soi, doit être considéré comme n’étant, en dernière analyse, qu’un aspect de la matière.
[p.105] Strictement parlant, l’affirmation de la seule réalité de la matière est un athéisme, car le panthéisme aussi est une forme d’athéisme. Bien que profondément enraciné dans le matérialisme, le consciencisme n’est pas nécessairement athée.
Pour le consciencisme, certaines activités présentant tous les signes de l’intention peuvent être néanmoins l’activité directe de la matière. Ce genre d’activité est très répandu et se caractérise par une réaction non aperceptive aux stimulations ; autrement dit, par une réaction dépourvue de toute conscience de soi, de toute cognition dépassant la réaction à ce qui, momentanément, agit comme stimulus. La réaction instinctive est cette sorte d’activité, car, dans la réaction instinctive, il y a réaction non aperceptive à un stimulus, une réaction qui n’est conditionnée par aucune intelligence d’une relation possible d’intention, entre le stimulus et le stimulé. Par contre, une réaction aperceptive est délibérée; en ce cas, il y a conscience de soi et appréciation de la situation qui comprend le stimulus et la réaction.
Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on se doute que les choses vivantes présentent des réactions non aperceptives. Descartes pensait même que les réactions de tous les animaux autres que l’homme étaient non aperceptives. Il niait donc que ces animaux possèdent une âme, se contentant, pour leurs actions, d’une explication purement mécanique. Mais même les humains ne sont pas au-dessus de la réaction non aperceptive. On peut d’ailleurs, par la production des réflexes conditionnés, rendre peu à peu non aperceptive une réaction aperceptive.
Avant Descartes, Aristote a défendu une opinion semblable : seuls les êtres humains sont capables de réaction consciente de soi, aperceptive. Cette opinion est manifestée par son invention d’une âme végétale et d’une âme animale, qu’il distingue de l’âme rationnelle.
Il pourrait sembler qu’une philosophie qui admet un dualisme de type cartésien ne peut, sans gêne, considérer [p.106] comme purement mécaniques toutes les actions des animaux. Pour ce genre de dualisme, il devrait en découler un doute cruel, celui de savoir si l’esprit en tant que catégorie ne peut réellement pas être excisé avec le rasoir d’Occam. Selon le rasoir d’Occam, il ne faut pas multiplier, sans besoin logique, les entités.
Mais pour le dualisme cartésien, il y a deux types de substances qui sont irréductibles : la substance spirituelle, qui est purement active, qui pense et qui est non étendue, et la matière, qui est purement étendue et, au sens philosophique, inerte. Or, un grand nombre des actions des animaux, à en juger d’après ce qui se voit, sont tout à fait comparables à celles des hommes. C’est donc une sorte de malhonnêteté intellectuelle que de prétendre que ces actions sont produites par l’esprit dans un cas et non dans l’autre; cela, d’autant que Descartes se pose le problème de l’existence d’esprits autres que le sien propre et celui de Dieu.
Pour écarter cette crainte que le rasoir d’Occam soit utilisé pour raser l’esprit, il est nécessaire de montrer, sans se contenter de l’affirmer, que des actions apparemment ordonnées par l’esprit peuvent résulter de la simple matière.
Le faire, c’est montrer qu’un vocabulaire spiritualiste est réductible sans cesse à un vocabulaire matérialiste. Autrement dit, montrer que les expressions utilisées pour décrire les actes provoqués par l’esprit s’appliquent parfaitement à l’action mécanique ; presque, en fait, que les esprits rudimentaires ne sont que de la matière active. C’est ce qui a, en fait, été explicitement affirmé par Leibniz qui, en disant que la matière est un esprit rudimentaire, a abattu la barrière dressée entre les catégories de la matière et de l’esprit.
Dans le premier chapitre, j’ai montré avec un certain détail comment est possible la conversion ou réduction catégorielle ; au cours de la discussion, j’ai librement cité les travaux des logiciens. Si les phénomènes spirituels ne sont en réalité que le résultat des phénomènes matériels, rien d’étonnant à ce que le milieu, qui n’est qu’une disposition [p.107] de la matière, puisse favoriser, intensifier, voire créer la conscience. En outre, cela résout le problème des rapports entre l’âme et le corps. Cette solution revient parfois à couper le nœud gordien. Ce problème se présente comme suit : si on dit qu’il n’y a que deux types de substance, la matière et l’esprit, et si l’on admet les interactions entre eux, il faut se demander comment il peut y avoir interaction entre des substances si disparates. L’esprit est purement actif, pense et n’a pas d’étendue ; la matière est passive, étendue et sans conscience. Si l’on affirme la réalité de la seule matière, comme le font les matérialistes extrémistes, Ou si l’on affirme la réalité du seul esprit, comme il faut supposer que le faisait Leibniz, le problème des rapports entre l’esprit et le corps est résolu parce qu’on a écarté les conditions dans lesquelles il se pose. C’est couper le nœud gordien, car désormais, l’esprit et le corps ne seront plus disparates, mais seront soit tous deux des formes de la matière, soit tous deux des formes de l’esprit.
Dans le consciencisme, en revanche, l’interaction de l’esprit et du corps est admise comme fait. La difficulté philosophique qu’elle entraîne est écartée par la démonstration de la possibilité de la conversion catégorielle. Celle-ci doit être distinguée du parallélisme. Descartes lui-même tenta de résoudre ce problème grâce à une sorte de parallélisme. Il imagina des événements concomitants et expliqua, par exemple, la souffrance comme le chagrin que ressentait l’âme quand on endommageait son corps. Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, Descartes fut attaqué par la critique d’Anthony William Amo. Pour Amo, tout ce que l’âme pourrait faire, dans l’hypothèse de Descartes, ce serait de prendre connaissance du fait qu’il y a un trou dans son corps ou un bleu sur sa peau : à moins que la connaissance ne soit pénible en elle-même, l’esprit ne pourrait pas souffrir de cela. Bien entendu, si l’on pouvait dire que l’esprit souffre de cette façon, simplement parce qu’il sait dans quel état est le corps, il serait possible de dire que le corps peut [p.108] affecter l’esprit ; mais ce ne serait pas nécessaire, car, strictement parlant, le corps, pour Descartes, n’affecte pas l’esprit, qui a simplement pitié du corps.
Il n’y a pas de place, dans le consciencisme philosophique, pour un simple parallélisme sur la question des rapports entre le corps et l’esprit. Il retient, en effet, les deux catégories que sont le corps et l’esprit, reconnaît le problème en acceptant le fait de l’interaction, mais y propose une solution. Tout en reconnaissant les deux catégories, le parallélisme nie en fait l’interaction. La solution proposée par le consciencisme fait intervenir la conversion catégorielle.
Pour le consciencisme, les qualités sont engendrées par la matière. Derrière toute apparence de qualité, il y a une disposition quantitative de la matière, telle que l’apparence de qualité lui soit subordonnée. Je ne prétends pas que les qualités soient les quantités elles-mêmes. Je ne dis pas, par exemple, qu’une couleur est la même chose qu’une certaine longueur d’onde. Bien entendu, la longueur d’onde n’est pas la couleur, quoique les physiciens nous apprennent que chaque couleur correspond à une longueur d’onde précise. Ce que je dis, c’est que la couleur est la conséquence visuelle d’une longueur d’onde. Une couleur est la façon dont l’œil ressent une onde ayant certaines propriétés mathématiques; c’est la conséquence visuelle d’une disposition quantitative de la matière. De même, les sons sont la façon dont l’oreille ressent des ondes douées de certaines propriétés. D’une manière générale, les sensations et les perceptions sont les conséquences sensorielles des dispositions quantitatives de la matière.
Au premier chapitre, j’ai réfuté l’objection qui veut que la théorie de la relativité, d’Einstein, soit incompatible avec le matérialisme. Le fond de cette objection est qu’une philosophie matérialiste implique l’existence indépendante et absolue de l’espace et du temps, réceptacles nécessaires de la matière. A ce sujet, j’ai expliqué qu’il n’y avait pas conflit [p.109] avec la théorie de la relativité, et aussi que le matérialisme en lui-même était incompatible avec l’existence indépendante et absolue de l’espace ou du temps.
Si l’on affirme que seule la matière existe, l’espace et le temps, n'étant pas de la matière, sont irréels. Mais le consciencisme n’affirme pas que seule la matière est réelle. Il affirme plutôt la réalité première de la matière. Là encore, si l’espace était absolu et indépendant, la matière ne pourrait être première par rapport à lui. En affirmant la primauté de la matière, le consciencisme affirme en retour que, dans la mesure où il est réel, l’espace doit tirer ses propriétés de celles de la matière par une conversion catégorielle. Or, comme les propriétés de l’espace sont d’ordre géométrique, le consciencisme implique que la géométrie de l’espace soit déterminée par les propriétés de la matière.
Si maintenant nous nous tournons vers la théorie générale de la relativité, due à Einstein, nous y trouvons exactement la même conclusion. Dans cette théorie, en effet, Einstein s’appuie sur un principe de Mach concernant les conditions de signification, pour affirmer que les propriétés de l’espace sont fixées par les masses des corps qui se trouvent dans un champ de gravitation. Comme le consciencisme, ce principe d’Einstein rejette l’existence indépendante et absolue de l’espace. En ce qui concerne l’espace, relativité et consciencisme s’impliquent mutuellement.
En discutant la possibilité de la conversion catégorielle, j’ai dit que la philosophie pouvait y accéder par deux avenues. Tout d’abord, la possibilité de cette conversion peut être démontrée à l’aide de concepts. C’est ce qu’a fait la logique moderne. Ensuite, on peut citer des modèles remplissant les conditions de cette conversion. C’est ce que fait la science moderne.
Le consciencisme affirme la réalité de la conversion catégorielle. Mais si on ne veut pas que ce passage d’une catégorie à une autre soit une simple apparition, un feu follet philosophique, il faut que cette conversion représente une [p.110] variation dans la masse de la matière initiale. La conversion est produite par un processus dialectique, et, si elle se fait d’un type logique inférieur à un type logique supérieur, elle entraîne une perte de masse.
Là encore, le fait que la perte de masse se produit réellement peut se déduire de la théorie d’Einstein. Celle-ci comporte que toute transformation chimique, allant de substances simples à des substances plus complexes, si elle entraîne l’apparition de propriétés nouvelles, représente une perte de masse. En fait, elle représente la conversion d’une portion de la masse de matière. Dans la théorie d’Einstein, la perte est calculable par la formule générale e = mc², où e représente les ergs d’énergie, m, la masse, et c, la vitesse de la lumière. Si, par exemple, on substitue à m une masse de 1 gramme, l’équivalence en énergie sera de 9 X 2010 ergs, car, dans ce cas, e sera égal à c2. Pour la philosophie que j’appelle consciencisme, par contre, bien que toute la masse soit convertie, elle n’est pas intégralement convertie en propriétés nouvelles. Dans une transformation chimique réelle, une partie de la masse se dégage sous forme de chaleur.
C’est cette réalité de la conversion catégorielle qui amène le consciencisme à affirmer non pas la réalité exclusive de la matière, mais sa réalité première. Si les catégories supérieures ne sont que des traductions des processus quantitatifs affectant la matière, cela ne suffit pas à en faire de vains semblants : elles sont parfaitement réelles.
Il s’ensuit que, dans le consciencisme, la matière est capable de transformation dialectique, car ses propriétés naturelles ne sont pas autre chose que la traduction de dispositions quantitatives de la matière ; si donc les propriétés naturelles sont modifiées, la matière doit changer de disposition quantitative. Or, la matière, étant un ensemble de forces entre lesquelles il y a tension, contient déjà un début de ce changement de disposition qui est nécessaire pour produire un changement de qualité ou de propriété. La force elle-même est la façon dont existent les particules de la [p.111] matière ; c’est leur constitution mathématique ou quantitative. La force n’est pas la description d’une particule de matière ; ce n’est pas quelque chose que les particules de matière portent sur le visage. Ce serait plutôt quelque chose qui leur est interne.
Comme la matière est un ensemble de forces entre lesquelles il y a tension, et comme la tension est une transformation à l’état naissant, il faut que la matière ait originellement le pouvoir de se mouvoir. Sans mouvement indépendant, la transformation dialectique serait impossible.
Par transformation dialectique, j’entends l’apparition d’un troisième facteur, de type logique supérieur, à partir de la tension entre deux facteurs ou jeu de facteurs de type logique inférieur. La matière appartient à l’un des types logiques ; les propriétés et qualités à un type logique supérieur; et les propriétés de propriétés à un type logique encore supérieur.
Tout cela, bien entendu, nous amène à nous poser, au sujet du consciencisme, des questions d’ordre épistémologique. Les problèmes épistémologiques sont ceux qui concernent la nature de la connaissance et ses types ainsi que les moyens qu’a l’esprit d’y parvenir. En s’abstenant d’affirmer que seule la matière existe, le consciencisme se prépare à reconnaître sans gêne l’objectivité des divers types d’être. En fait, la notion même de dialectique implique que l’on reconnaisse divers types d’être. Les types d’être sont des types logiques. S’ils constituent une échelle d’être, il ne faut pas en inférer qu’une échelle de valeurs est parallèle à cette échelle d’être. Les types sont des types logiques, tels que les objets matériels constituent un type logique ; les termes généraux qui ne peuvent être utilisés que pour décrire des objets matériels constituent un type logique supérieur ; et les termes généraux utilisables pour décrire les termes généraux du premier groupe constituent un autre type logique, encore supérieur.
Les objets matériels appartiennent à des types logiques [p.112] différents de leurs propriétés et différents de ceux de l’esprit. Ce sont ces différences de type qui rendent possible l’absurdité en matière de catégories. J’entends par là le genre particulier d’absurdité qui vient de ce qu’on accouple des types de termes qui ne devraient pas être accouplés. On ne doit accoupler les termes que quand ils appartiennent soit au même type, soit à des types voisins. Ainsi, « peuple » et « indépendance » appartiennent à des types voisins ; on peut donc les accoupler, par exemple dans la proposition : « Nous sommes un peuple indépendant. » Mais le nombre « deux » et « rouge » n’appartiennent ni au même type, ni à des types voisins ; donc, ainsi qu’on pouvait s’y attendre, la proposition « le nombre deux est rouge », qui les accouple, tombe dans l’absurdité catégorielle.
De même, les termes qui peuvent être accouplés à des traductions philosophiques dans la description de ces dernières ne peuvent être accouplés aux réalités ainsi traduites, bien qu’il n’y ait rien qui ne soit susceptible d’être transformé sans reste en propositions concernant ces réalités.
Les termes qui peuvent être accouplés avec des traductions philosophiques dans une description de ces dernières ne peuvent être accouplés avec les réalités ainsi traduites, car, si un terme peut être accouplé à une traduction philosophique, il doit être du même type logique qu’elle, ou, si cela se présente dans une description de cette traduction, d’un type supérieur à, et voisin de ce à quoi appartient la traduction. Les termes qui peuvent, dans une description, être accouplés à une traduction philosophique doivent être supérieurs d’un type logique à cette traduction, car ces termes sont toujours supérieurs d’un type à leur sujet. Il en découle que ces termes sont supérieurs de deux types au moins aux objets traduits. Es ne peuvent donc leur être attribués, même par voie de complément. On ne peut dire que le nombre deux soit une chose rouge (complément), pas plus qu’on ne peut' dire que le nombre deux soit rouge (description).
Cette conséquence épistémologique duc consciencisme phi-[p.113]losophique fournit une justification philosophique a priori pour des recherches telles que l’investigation de la nature de l’esprit au moyen de l’étude exclusive de la nature et du fonctionnement du cerveau. C’est un grand avantage, car, comme l’esprit ne fait pas l’objet d’expériences, si toutes les propositions faites au sujet de l’esprit sont, par principe, traduisibles sans reste en propositions concernant le système nerveux, qui, lui, est objet d’expérience, on peut faire toutes sortes de recherches sur la pensée sous forme de recherches neurologiques. D’une façon générale, le consciencisme réduit « l’ermitage académique » en permettant d’étudier la nature d’une catégorie à travers une autre catégorie.
De plus en plus, certains philosophes estiment que, quand le matérialisme aura triomphé de l’idéalisme, il devra, comme sa victime, disparaître ou «s’étioler » en tant que philosophie. On pense que cela se produira quand la société sans classes sera réalisée. Marx et Engels considéraient le matérialisme comme la véritable forme de la science et croyaient même que, quand l’idéalisme aurait été définitivement écrasé, le matérialisme devait avoir la science pour contenu positif. L’important n’est pas tant qu’il ne soit plus nécessaire d’enseigner le matérialisme en tant que philosophie une fois que l’idéalisme aura été écrasé, mais plutôt que l’importance et la justesse du matérialisme ne seront aucunement diminuées à l’heure de sa victoire. Certains philosophes prévoient qu’il disparaîtra alors et cédera la place à une philosophie de l’esprit, et que celle-ci, qui n’est pas exactement préfigurée par le matérialisme, ouvrira la porte à un nouvel idéalisme.
La théorie sans pratique est vide, et le consciencisme présente à chaque instant des applications pratiques, comme celle que nous avons exposée. Si le consciencisme affirme au départ que la matière est absolue et indépendante, et la juge douée de ses lois objectives et originelles, il se construit en devenant un reflet de l’objectivité, en termes conceptuels, de l’évolution de la matière. Quand une philosophie se limite ainsi à être un reflet de l’évolution objective de la matière, [p.114] elle établit aussi un lien direct entre connaissance et action.
L’idée d’une philosophie qui serait l’image conceptuelle de la nature se trouve également chez Spinoza ; on peut même dire qu’elle fait partie du rationalisme en général. Pour Spinoza, en tout cas, l’ordre et le lien entre les idées sont les mêmes que l’ordre et le lien dans la nature. L’erreur des rationalistes, au sujet des rapports entre philosophie et nature, consiste à traiter la philosophie comme le photocalque, la camisole de force de la nature, au lieu de se contenter d’admettre qu’elles sont le reflet l’une de l’autre. Mais si l’ordre et le lien entre les idées sont les mêmes que l’ordre et le lien dans la nature, alors, selon Spinoza, la connaissance d’un de ces ordres et liens doit être la connaissance de l’autre. On peut même dire que, pour Spinoza, l’esprit est l’idée de ce dont le corps est la nature. Dans la mesure où cet auteur croit l’action possible, la connaissance de l’esprit peut être le fondement objectif direct d’une action sur la nature.
J’ai dit plus haut qu’en dépit de l’abîme qu’il y a entre l’idéalisme et le matérialisme, ils ne proposent pas d’inventaires du monde différents. Mais cela ne veut absolument pas dire qu’ils aient la même attitude à l’égard du monde. Leurs conceptions des rapports entre la pensée et l’action diffèrent certainement. Sur ce point, l’idéalisme est vain et ridiculement inefficace. Le matérialisme, lui, est dynamique et présente à chaque instant des applications pratiques.
Mais si le consciencisme relie la connaissance à l’action, il reste nécessaire de se demander s’il imagine ce lien comme purement mécanique ou, au contraire, susceptible d’influence et de commentaire éthiques.
Il est au moins évident que le consciencisme ne peut déboucher sur une liste close de règles morales, applicables dans n’importe quelle société, à n’importe quelle époque. Il en est incapable, car il est lui-même fondé sur une conception de la matière d’après laquelle celle-ci est prise dans l’engrenage d’une inexorable évolution dialectique.
[p.115] Dans la mesure où le matérialisme débouche sur un égalitarisme sur le plan social, il débouche sur une éthique. L’égalitarisme est non seulement politique, mais encore éthique ; il implique une certaine limitation de l’étendue des conduites humaines qui lui sont acceptables. En même temps, comme il conçoit la matière comme un faisceau de tensions suscitant une transformation dialectique, il ne peut congeler ses règles morales dans l’immuabilité. Il serait pourtant faux d’en conclure que les principes moraux sanctionnés par le consciencisme sont, à quelque moment que ce soit, gratuits et dépourvus de fondement objectif ; en effet, même quand les règles varient, elles peuvent toujours être informées et gouvernées par les mêmes principes de base, à la lumière de la nouvelle situation sociale.
Il est indispensable de bien comprendre les rapports entre règles et principes. Ces rapports sont comparables à ceux qu’il y a entre l’idéal et les institutions, ou entre les statuts et les règlements. Les statuts, bien sûr, posent des principes généraux ; ils n’explicitent pas les procédures par lesquelles on pourra les appliquer. Les règlements sont des applications de ces principes. Il est visible que, quand les conditions d’application des règlements sont modifiées de façon appréciable, il peut être nécessaire d’amender les règlements pour que le même statut continue à être appliqué. Les statuts ne sont pas au même niveau que les règlements, et ils n’impliquent aucun règlement particulier. C’est précisément parce que les statuts n’impliquent aucun règlement particulier, et qu’ils peuvent être appliqués au moyen de n’importe lequel des règlements qu’il est possible d’amender les règlements, tandis que les statuts qu’ils sont destinés à faire appliquer ne souffrent aucun changement.
Les rapports entre l’idéal et les institutions sont du même ordre. Dire que les circonstances changent est un truisme. Cela n’empêche que cela a un sens. Cela signifie en effet que, si l’on veut appliquer l’idéal à travers toutes les vicissitudes de la vie, il peut être nécessaire de modifier ou de rem-[p.116]placer les institutions pour que le même idéal soit effectivement servi. Il n’y a pas d’institutions particulières qui, quelles que soient les conditions locales, dépendent de l’idéal uniquement. Les institutions doivent être toutes imprégnées de pragmatisme.
Il y a entre les principes et les règles le même rapport, même quand celles-ci sont d’ordre moral. Un instant de réflexion confirme que les règles morales peuvent, et même doivent, changer.
Il est évident que, même quand deux sociétés partagent les mêmes principes moraux, elles peuvent leur donner des règles d’application différentes. En Israël, les ânes étaient si importants que Dieu jugea nécessaire de régler les relations humaines par une ordonnance morale les mentionnant expressément : « Tu ne convoiteras point l’âne de ton prochain. » Si Dieu daignait nous donner aujourd’hui une règle équivalente, il nous interdirait certainement de convoiter la voiture de notre prochain et non son âne. En ce cas, Dieu donnerait une règle morale nouvelle, destinée à faire appliquer un principe moral inchangé, mais tenant pleinement compte de la vie moderne.
Les progrès dans la domestication des forces de la nature ont eu un profond retentissement sur le contenu des règles de la morale. Certaines d’entre elles tombent en désuétude parce que les situations où elles ont un sens n’ont plus aucune chance de se reproduire ; d’autres laissent la place à leur contraire, par exemple quand une société matriarcale devient patriarcale, car, en ce cas, bien des règles morales nées de la situation de la femme céderont à celles qu’entraîne la situation nouvelle de l’homme. Pourtant, les principes sur lesquels reposent ces diverses catégories de lois morales restent constants, et ne varient pas d’une société à l’autre.
Pour le consciencisme, les lois morales ne sont pas permanentes, mais dépendent du stade atteint par la société dans son évolution historique, de telle sorte, cependant, que les principes cardinaux de l’égalitarisme soient préservés.
[p.117] Une société ne change pas de morale simplement en changeant de lois. Pour que la morale change, il faut que les principes changent. Par exemple, si une société capitaliste peut devenir une société socialiste, il faut, pour cela, qu’elle change de morale. Tout changement de morale est révolutionnaire.
Bien souvent, néanmoins, les règles morales ont changé si brusquement qu’on avait l’impression d’une révolution de l’éthique. On peut prendre par exemple le changement profond, dû à la psychologie moderne, dans notre attitude envers les délinquants. La psychologie nous fait connaître des faits importants que nous ne soupçonnions pas. Notre morale n’a pas nécessairement changé parce que ces faits nouveaux modifient notre attitude ; simplement, nous hésitons à appliquer les anciennes règles parce que nos connaissances nouvelles nous incitent à rejuger l’acte incriminé et, le cas échéant, à lui faire correspondre une règle morale différente. Dans ce cas, une attitude morale différente peut devenir pertinente.
Les recherches sur la psychologie de la délinquance sont un exemple topique. Leurs résultats tendent à atténuer notre rigueur morale à l’endroit des délinquants, en nous obligeant non pas, certes, à renoncer à la morale, mais à reclasser les actes délinquants.
Le grand principe moral du consciencisme est de traiter chaque être humain comme une fin en soi, et non comme un simple moyen. Cela est essentiel dans toutes les conceptions de l’homme socialistes ou humanistes. Il est vrai qu’Emmanuel Kant aussi en faisait un principe capital de l’éthique, mais, alors qu’il y voyait une évidence rationnelle, nous le déduisons de notre point de vue matérialiste.
Cette déduction est possible en passant par l’égalitarisme qui, nous l’avons vu, est le reflet du matérialisme sur le plan social. L’égalitarisme repose sur la thèse moniste du matérialisme. La matière est une, même dans ses diverses manifes-[p.118]tations. Si la matière est une, il s’ensuit qu’il y a moyen de passer d’une manifestation de la matière à n’importe quelle autre. Cela ne veut pas dire qu’entre deux quelconques manifestations de la matière, il y ait une route qui ne passe par aucune troisième forme ; cette route n’est pas nécessairement directe, car elle peut nous ramener à la forme première de la matière. Les processus dialectiques ne sont pas unilinéaires, mais ramifiés. Il y a une route de n’importe quel rameau d’un arbre à n’importe quel autre rameau, sans jamais quitter l’arbre. Mais cela ne veut pas dire que tous les rameaux ont un point commun, car il peut être nécessaire de passer par le tronc et de se rendre sur une autre branche pour passer d’un rameau sur l’autre. Néanmoins, cette voie existe. Les différentes manifestations de la matière résultent toutes de processus dialectiques se déroulant selon des lois objectives. Il y a un procédé donné par lequel apparaît toute manifestation.
Mais, en disant qu’il y a une voie entre toutes les formes de la matière, je ne sous-entends pas que n’importe quelle forme de matière puisse être tirée de n’importe quelle autre forme, car cela pourrait impliquer le renversement d’un processus irréversible. L’ultime conclusion de notre pensée est la continuité de la nature : bien que l’évolution dialectique de la matière puisse aboutir à un cul-de-sac (comme les plantes et animaux de la préhistoire dont les espèces se sont éteintes), l’évolution dialectique ne contient pas de hiatus.
C’est l’unité fondamentale de la matière, en dépit de ses manifestations variées, qui entraîne l’égalitarisme. Fondamentalement, l’homme est un, car tous les hommes ont le même fondement et proviennent de la même évolution, enseigne le matérialisme. Tel est le fondement objectif de l’égalitarisme.
David Hume a posé la question de savoir pourquoi les philosophies morales commencent par des constatations de faits puis, soudain, cherchent à fonder là-dessus des jugements de valeur, sans expliquer la légitimité de ce passage.
[p.119] Si l’homme est fondamentalement un, si, par conséquent, l’action tient objectivement compte de ce fait, elle doit être guidée par des principes. On peut formuler les principes directeurs à une degré de généralité tel qu’ils deviennent autonomes. Autrement dit, si, tout d’abord, l’action doit être conforme à l’objectivité de l’unité humaine, elle doit être guidée par des principes généraux qui ne perdent jamais de vue l’objectivité et qui empêchent l’action de se faire comme si les hommes étaient fondamentalement différents. Deuxièmement, ces principes, étant rapportés à des faits, peuvent être posés hardiment, comme s’ils étaient autonomes ; en voici un exemple : nul ne doit traiter quelqu’un d’autre comme un moyen, mais toujours comme une fin.
Si les principes moraux sont fondés sur l’égalitarisme, ils doivent être objectifs. Si les principes moraux viennent de la conception égalitaire de la nature de l’homme, ils doivent être généralisables, car, dans cette conception, l’homme est fondamentalement un au sens que nous avons dit. C’est cette généralisation non différenciée qui est exprimée par le commandement de traiter tout homme comme une fin en soi et non pas comme un moyen. Autrement dit, bien qu’il ait le même grand principe que la morale de Kant, le consciencisme diffère du kantisme en ceci qu’il fonde l’éthique sur une conception philosophique de la nature de l’homme. C’est ce que Kant appelle une éthique fondée sur l’anthropologie. Par anthropologie, Kant entend toute étude de la nature de l’homme, et il ne veut pas que l’éthique repose sur une telle étude.
Or, c’est précisément ce que fait le consciencisme philosophique. Il s’accorde également avec la pensée traditionnelle africaine sur beaucoup de points, et, en ceci, il répond à une des conditions qu’il s’est imposées. En particulier, il s’accorde avec l’idée africaine traditionnelle de l’existence indépendante et absolue de la matière, avec l’idée qu’elle a le pouvoir de se mouvoir d’elle-même au sens que nous avons expliqué, avec l’idée de la convertibilité catégorielle et avec [p.120] celle que les grands principes de la morale sont fondés sur la nature de l’homme.
Bien entendu, la pensée africaine traditionnelle accepte l’idée que la matière est absolue et indépendante. Si l’on prend pour exemple la philosophie de l’Africain, on constate que l’existence absolue et indépendante de la matière y est acceptée. De plus, la matière n’est pas un poids mort, mais elle vit par la tension qui existe entre des forces. Mieux, pour l’Africain, ce qui existe vit en tant que faisceau de forces entre lesquelles il y a tension. Puisqu’il estime que la tension de forces est essentielle à tout ce qui existe, l’Africain attribue à la matière, comme Thalès et les consciencistes, le pouvoir originel de se mouvoir d’elle-même ; ces derniers lui attribuèrent ce dont elle aurait besoin pour prendre l’initiative de transformations qualitatives et catégorielles.
Quand plusieurs hommes vivent en société, et que l’on admet que chacun doit être traité comme une fin en soi, et non simplement comme un moyen, on entrevoit une transition entre l’éthique et la politique. La politique devient réelle, car il faut créer des institutions pour régler le comportement et l’action de tous les hommes qui vivent en société, de façon à maintenir le principe éthique fondamental de la valeur originelle de chaque individu. En conséquence, le consciencisme propose une théorie politique et une pratique socio-politique qui, ensemble, tentent d’assurer le respect des principes fondamentaux de la morale.
La pratique socio-politique est destinée à empêcher qu’apparaissent ou que s’affermissent des classes, car, dans la conception marxiste de la structure de classe, s’il y a des classes, il y en a une qui exploite et assujettit les autres. Or, l’exploitation et la sujétion de classe sont en opposition au consciencisme. éprise d’égalité, notre philosophie cherche à développer l’individu, mais de telle sorte que les conditions du développement de tous deviennent celles de l’épanouissement individuel ; autrement dit, de telle sorte que l’épanouissement individuel n’entraîne pas des diversités [p.121] propres à mettre en question le fondement égalitaire de la société. Ainsi, la pratique socio-politique cherche à coordonner les forces sociales de façon à les mobiliser logistiquement en vue du développement maximal de la société dans une ligné authentiquement égalitaire. Pour cela, il est indispensable de planifier le développement.
Sous son aspect politique, le consciencisme se heurte aux réalités suivantes: colonialisme, impérialisme, désunion et développement insuffisant. Chacune d’elles et les quatre ensemble militent contre la réalisation d’une justice sociale fondée sur l’idée d’égalité authentique.
La première chose à faire est de liquider le colonialisme partout où il se manifeste. Dans Towards Colonial Freedom j’ai établi que les gouvernements colonialistes entendaient utiliser leurs colonies comme productrices de matières premières et comme marchés avantageux pour les produits manufacturés des industriels et capitalistes étrangers. J’ai toujours cru que la cause profonde du colonialisme est d’ordre économique ; pourtant, la solution du problème colonial est dans une action politique, dans une lutte féroce et implacable pour l’émancipation, premier pas vers l’indépendance et l’intégrité économiques.
J’ai dit plus haut que le consciencisme voit dans la matière un faisceau de forces entre lesquelles il y a tension, et que, sous son aspect dialectique, il croit possible la conversion catégorielle, par une disposition critique de la matière. Cela nous donne la clé de l’analyse du fait colonial, non seulement en Afrique, mais partout. Cela nous montre aussi comment en venir à bout.
Dans une situation coloniale, il y a des forces qui favorisent le colonialisme, qui favorisent ces liens par lesquels une métropole s’attache ses colonies dans l’intention essentielle d’en retirer un profit. Le colonialisme nécessite la contrainte, et une bonne part de cette contrainte est engloutie dans l’opposition faite aux forces de progrès, lesquelles cherchent [p.122] à annuler cette entreprise d’oppression lancée par des classes et des individus avides, cette domination égoïste des forts sur les faibles.
De même que, tel l’arc d’Héraclite, l’immobilité apparente de la matière recouvre en réalité la tension d’un faisceau de forces, de même, dans un pays colonisé, une opposition de forces réactionnaires et révolutionnaires peut donner malgré tout l’impression d’une sujétion définitive et acceptée. Mais, de même que, par une variation quantitative (= mesurable) de la matière, portant sur un point critique, l’équilibre peut être modifié, de même cet acquiescement apparent peut cesser brusquement, si un changement intervient dans l’équilibre des forces sociales. Ces faisceaux de forces en opposition sont dynamiques en ce sens qu’ils tendent à instituer une certaine situation sociale. On peut donc les désigner du nom d’actions, pour expliciter leur caractère dynamique. En ce cas on peut dire qu’il faut distinguer, dans une situation coloniale, une action positive et une action négative. L’action positive représentera la somme des forces qui tentent d’établir la justice sociale en abolissant l’exploitation et l’oppression par une oligarchie. L’action négative représentera la somme des forces qui tendent à prolonger la sujétion et l’exploitation coloniales. L’action positive est révolutionnaire, l’action négative, réactionnaire.
Il faut reconnaître d’emblée que ces termes que nous proposons, « action positive ou négative», sont des abstractions. Mais ils sont justifiés par la réalité sociale. On peut parfaitement, par l’analyse statistique, déceler, dans n’importe quelle société, les liens entre l’action positive et l’action négative. L’analyse en question portera sur des faits comme la production, la distribution, le revenu, etc. Toute analyse de ce genre doit révéler l’une des trois situations possibles que voici : l’action positive peut excéder l’action négative, l’action négative peut excéder l’action positive, ou bien elles peuvent se trouver en équilibre instable.
Dans une situation coloniale, l’action négative excède [p.123] indubitablement l’action positive. Pour qu’il y ait indépendance, véritable, il faut que l’action positive parvienne à excéder l’action négative. On admet qu’un semblant d’indépendance est possible sans cette relation spécifique. Quand cela se produit, nous disons qu’il y a néo-colonialisme, car ce dernier est un déguisement adopté par l’action négative pour donner l’impression qu’elle a cédé à l’action positive. Le néo-colonialisme est une action négative qui feint d’être vaincue prévenir les effets, il faut que l’action positive soit souvent soutenue par un parti de masse, et que cette masse se perfectionne : il faut, par l’instruction et l’élévation de son degré de conscience politique, la rendre plus apte à l’action positive. On peut donc dire que, dans un pays colonisé, l’action positive doit être soutenue par un parti de masse, disposant de moyens d’éducation. C’est pourquoi, au Ghana, le Convention People’s Party se donna, dès ses débuts, une section de l’instruction, une section du travail, une section agricole, une section «jeunesse », une section féminine, etc. De la sorte, le peuple recevait régulièrement une instruction politique, sa conscience de soi s’approfondissait et il apprenait à se concevoir lui-même d’une façon excluant systématiquement le colonialisme et tous ses déguisements. Le caractère révolutionnaire de ce Parti consiste également dans le soutien de millions de membres et de sympathisants, unis par un dessein radical commun, et non simplement dans l’originalité de ses programmes. Le soutien qu’il reçoit de la nation entière lui permet de songer avec réalisme à introduire des changements fondamentaux dans l’imbroglio social qu’a laissé le colonialisme.
La démocratie parlementaire d’un peuple à parti unique exprime et satisfait les aspirations communes de l’ensemble de la nation mieux qu’un système parlementaire à plusieurs partis, qui ne serait en réalité qu’une ruse pour perpétuer de façon sournoise la lutte inévitable entre les « nantis» et les « dépossédés ».
[p.124] Pour qu’un territoire acquière les attributs nominaux de l’indépendance, il n’est évidemment pas indispensable que l’action positive excède l’action négative. Quand un pays colonisateur constate les progrès de l’action positive, il se lance inévitablement dans une politique de freinage par laquelle il tente de stopper ces progrès et d’en limiter les effets. Cette politique prend souvent la forme de conférences et de réformes constitutionnelles à long terme.
Pour cela, il recourt à divers moyens subtils. Ayant renoncé à la violence ouverte, il donne aux forces négatives du pays assujetti une orientation fallacieuse. Ces forces sont, sur le plan politique, des « loups qui viennent en vêtements de brebis » : ils applaudissent aux réclamations d’indépendance et le peuple les écoute de bonne foi. C’est alors que, comme une épidémie, ils tentent, de l’intérieur, d’infecter, de corrompre, de pervertir et de fausser les aspirations du peuple.
Le peuple, corps et âme de la nation, ultime auteur des décisions politiques et détenteur de la souveraineté, ne peut être abusé longtemps. Prompt à flairer le gibier, il déniche ces politiciens hypocrites qui courent avec le lièvre et chassent avec les chiens, et il les rejette. Une fois que ce subterfuge colonialiste est éventé et les collaborateurs discrédités, la puissance colonisatrice ne peut que reconnaître l’indépendance du peuple. Mais son premier soin est de chercher, par des moyens vulgaires, à neutraliser cette même indépendance : elle fomente le mécontentement et la désunion, et, pour finir, elle tente, par une cour éhontée, de priver le peuple de ce qu’il a conquis, de se substituer à sa conscience et à sa volonté, sinon à sa voix et à son bras. Exactement comme avant la conquête de l’indépendance, les décisions politiques sont sans référence au bien public, et une fois de plus, servent le bien-être et la sécurité de l’ancienne puissance coloniale et de la clique des politiciens égocentriques.
Toute tentative oblique d’un pays étranger pour fausser, [p.125] corrompre ou pervertir de quelque façon que ce soit l’indépendance véritable d’un peuple souverain est un néo-colonialisme. C’en est un parce que, bien que ce pays reconnaisse la souveraineté du peuple en question, il cherche à faire passer les intérêts d’une puissance étrangère avant ceux de ce peuple.
En fait, il peut arriver qu’un pays colonisateur offre l’indépendance à un peuple non pas avec l’intention que l’on pourrait supposer à un tel acte, mais dans l’espoir que les forces positives et progressistes en seront endormies, et que l’on pourra exploiter le peuple plus aisément et plus tranquillement.
Pour les pays indépendants, le néo-colonialisme est plus dangereux que le colonialisme Le colonialisme est brutal, essentiellement ouvert, et on peut en triompher en mobilisant rationnellement l’effort national. Mais dans le cas du néocolonialisme, le peuple est coupé de ses chefs, et, au lieu de faire leur travail, qui devrait toujours être inspiré par l’idéal du bonheur général, ceux-ci en viennent à négliger le peuple même qui les a portés au pouvoir et, par suite de leur imprudence, deviennent les instruments de la tyrannie qui profite aux néo-colonialistes.
Il est beaucoup plus facile au chameau de passer, bosse comprise, par le chas d’une aiguille, qu’à une ancienne administration coloniale de donner des conseils sains et honnêtes, d’ordre politique, au territoire libéré. Laisser un pays étranger, en particulier un pays qui a investi en Afrique, nous dire quelles décisions politiques prendre, quelle ligne politique suivre, c’est vraiment rendre notre indépendance à nos oppresseurs sur un plateau d’argent.
De même, comme le colonialisme, si changeant soit-il dans ses apparences, a des raisons essentiellement économiques, comme il n’est que l’institution de liens politiques asservissant les colonies au pays colonisateur, avec pour but essentiel de valoir des avantages économiques à ce dernier, il est capital, pour un territoire libéré, de ne pas [p.126] lier son économie à celle des gens qu’il a mis à la porte. La libération d’un peuple entraîne des principes exigeant le dépistage et l’abolition de la domination impérialiste, qu’elle soit politique, économique, sociale ou culturelle. Pour abolir la domination impérialiste sous toutes ses formes, il faut que l’action politique, économique, sociale et culturelle se réfère toujours aux besoins et à la nature du territoire libéré, et c’est de ces besoins, de cette nature, que l’action doit tirer son authenticité. Si le territoire libéré ne veille pas avec un soin jaloux à se référer ainsi à lui-même, il accueillera à bras ouverts ce qu’il a tenté de supprimer au prix de terribles souffrances.
Le bonheur véritable d’un peuple ne souffre pas de compromis. Si nous acceptons des compromis sur les véritables intérêts de notre peuple, le peuple un jour nous jugera, car c’est par ses efforts et ses sacrifices, par sa patience et son abnégation que l’indépendance a été acquise. Une fois l’indépendance acquise, on peut gouverner contre l’ex-métropole, mais on ne peut vraiment pas gouverner contre la volonté et l’intérêt du peuple.
Le peuple est l’épine dorsale de l’action positive. C’est par l’effort du peuple que le colonialisme est expulsé, c’est à la sueur de son front que se construisent les nations. Le peuple est la réalité de la grandeur nationale. C’est le peuple qui souffre des déprédations et des brimades du colonialisme et il ne faut pas faire injure au peuple en se compromettant dangereusement avec les néo-colonialistes.
Il y a une loi fondamentale de l’évolution de la matière vers des formes supérieures. Cette évolution est dialectique. Et c’est aussi la loi fondamentale de la société. C’est d’une tension que l’être est né. Le devenir est une tension, et l’être est l’enfant de cette tension de forces opposées.
Exactement comme dans l’univers physique, puisque l’objet en mouvement est toujours sujet à des pressions extérieures, tout mouvement est en fait une résultante, dans la société, tout développement, tout progrès, sont la résultante [p.127] de forces contradictoires, le triomphe d’une action positive sur une action négative.
Ce triomphe doit être accompagné de connaissance. De même, en effet, que l’évolution naturelle peut être hâtée par l’intervention humaine fondée sur la connaissance, de même l’évolution sociale peut être facilitée par une intervention politique fondée sur la connaissance des lois du développement social. Une action politique visant à hâter l’évolution sociale est une sorte de catalyseur.
Le besoin d’un tel catalyseur vient de ce que l’évolution naturelle est toujours coûteuse. Elle se fait au prix d’une énorme perte de vie et de grandes tribulations. L’évolution hâtée par la connaissance scientifique est plus rapide et plus économique. De même, le catalyseur introduit dans l’évolution sociale par l’action politique représente une économie de temps, de vies et de talents.
Sans action positive, un territoire colonisé ne peut être vraiment libéré. Il est voué à se traîner pas à pas vers une indépendance dérisoire qui s’écoule entre ses doigts parce qu’elle est toute pétrie des intérêts d’une puissance étrangère. Pour aboutir à une libération véritable, il faut que l’action positive commence par une analyse objective de la situation qu’elle espère transformer. C’est une analyse de ce genre que j’ai tentée dans Towards Colonial Freedom. En outre, l’action positive doit chercher à rassembler toutes les forces progressistes et, en se mettant à leur tête, à attaquer les forces négatives. Elle doit aussi prévenir et dominer ses propres contradictions internes, car, bien que l’action positive unisse les forces d’un pays qui, eu égard à un dessein précis, sont progressistes, beaucoup de ces forces risquent de présenter des tendances à d’autres égards réactionnaires.
C’est pourquoi, quand l’action positive procède à un rassemblement de forces, elle crée en elle-même des points de suture qui peuvent craquer un jour. Il est essentiel que l’action positive prévienne, dans son évolution dialectique, [p.128] cette désintégration en germe et trouve un moyen d’empêcher les futurs schismes, de tuer dans l’œuf des dissensions au moment où le colonialisme commence à vaciller sous l’assaut direct de l’action positive.
Mais même quand le colonialisme est extirpé, l’action positive ne doit pas se relâcher, car c’est à ce moment que se manifestent les tendances schismatiques auxquelles j’ai fait allusion. En outre, bien qu’elle soit précieuse par elle-même, l’indépendance politique n’est malgré tout qu’un moyen en vue de la totale rédemption et réalisation du peuple. Quand l’indépendance a été conquise, l’action positive doit prendre une orientation nouvelle : ne plus viser simplement à détruire le colonialisme, et songer à la reconstruction nationale.
C’est même quand elle fait cette invitation à la reconstruction nationale que l’action positive court les plus grands dangers. La flatterie, la séduction, bref, la cour et tous les chevaux de Troie du néo-colonialisme demandent une résistance peu commune, car le néo-colonialisme est une sirène, un monstre qui attire ses victimes par une douce musique. Pour être en mesure d’opposer sur tous les fronts cette résistance au colonialisme, l’action positive doit être armée d’une idéologie qui, la vitalisant et s’appuyant sur un parti de masse, lui donne une conception énergétique du monde et de la vie, et qui lui apprend à se rattacher, sans solution de continuité, à notre passé, de même qu’à notre avenir. L’idéologie sera le phare à la lumière duquel nous pourrons juger tout fait intéressant la vie du peuple et dénoncer sans relâche les redoutables efforts et tours de passe-passe du néo-colonialisme.
Pour que cette idéologie soit totale, qu’elle éclaire tous les aspects de la vie de notre peuple, pour qu’elle concerne l’ensemble des intérêts de notre société, en créant une continuité avec notre passé, elle doit être socialiste, de forme et de contenu, et elle doit être adoptée par un parti de masse.
[p.129] Pourtant, le socialisme tend, dans l’Afrique d’aujourd’hui, à perdre son contenu objectif en faveur d’une terminologie déroutante et d’une confusion générale. La discussion porte sur les divers types concevables de socialisme plus que sur le besoin d’un développement socialiste. Il faut certainement plus qu’une simple réaction contre une politique de domination. L’indépendance appartient au peuple : elle a été gagnée par le peuple, pour le peuple. Toute théorie de la souveraineté qui est tant soit peu éclairée admet que l’indépendance est le bien inaliénable du peuple. Le succès, en tous lieux, des mouvements de masse, montre que c’est le peuple qui la conquiert. Et si le peuple possède la souveraineté, il est évident que c’est pour lui que l’indépendance est acquise. Le peuple ne maîtrise pas vraiment son indépendance tant qu’on n’a pas donné à celle-ci un contenu national et social qui engendre des avantages pour lui.
Si l’on ne veut pas que le peuple perde le bénéfice de son indépendance, il faut que le socialisme d’un territoire libéré obéisse à un certain nombre de principes. Quand le socialisme est fidèle à sa raison d’être, il cherche à se rattacher au passé égalitaire et humaniste du peuple, celui qui existait avant que son évolution sociale n’ait été déformée par le colonialisme ; parmi les résultats du colonialisme, il cherche lesquels peuvent être adaptés dans l’intérêt du peuple (par exemple, les méthodes nouvelles de production industrielle et d’organisation économique); il cherche à freiner et à prévenir les progrès des anomalies et inégalités créées par l’habitude capitaliste du colonialisme ; il réforme la psychologie du peuple, en la purgeant de la « mentalité coloniale » ; enfin, il défend résolument l’indépendance et la sécurité du peuple. Bref, le socialisme reconnaît la dialectique, la possibilité d’une création à partir de forces opposées ; il reconnaît le caractère créateur de la lutte et même la nécessité, pour toute transformation, de l’intervention de forces. Il comporte aussi le matérialisme et le traduit en termes d’égalité sociale.
A découvrir aussi
- Aimé Césaire. Lettre à Maurice Thorez,
- Amilcar Cabral. Sur la petite bourgeoisie
- Claude Lévi-Strauss. Race et histoire
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 165 autres membres